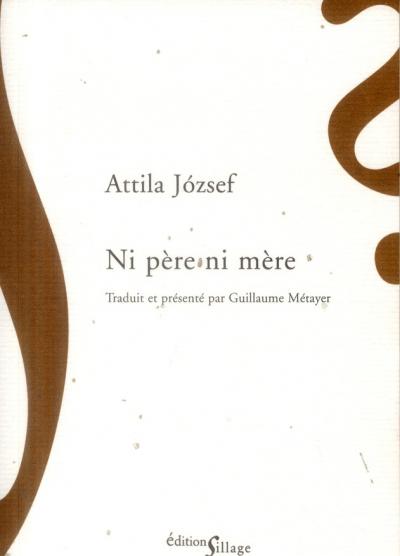Guillaume Métayer, traducteur du hongrois, mais aussi spécialiste de littérature hongroise et professeur à la Sorbonne, entre autres, a accepté de répondre à une interview. Je le remercie vivement pour ses réponses très développées, qui nous permettent d’en découvrir un peu plus sur Attila József ainsi que sur le métier de traducteur.
» J’aimerais d’abord savoir comment vous avez découvert la Hongrie et comment vous en avez appris la langue? »
Guillaume Métayer: » J’ai appris le hongrois lors d’un séjour en Angleterre. Je me suis rendu compte que j’avais au moins autant envie d’entrer dans un monde inconnu que de me donner les clefs de la langue globale. Le hongrois m’a étonné avant de me fasciner. En un sens, apprendre le hongrois était d’emblée un geste littéraire : détacher le langage des dimensions utilitaires de la communication et de l’information, au profit de l’évocation et du mystère. »
« Vous avez traduit de nombreux auteurs hongrois, mais aussi allemands, comment vous est venu ce goût pour la traduction? »
G.M: « J’ai poursuivi des études en « Lettres classiques ». Nous faisions des versions latines et grecques, et j’ai toujours rêvé de traduire les poètes latins (Horace en particulier) de la manière la plus juste et la plus forte possible. Je n’ai jamais réalisé ce rêve – plus tard peut-être ! Mais plus avant, je me souviens d’avoir tenté, adolescent, de traduire des balades de Goethe, sans trop savoir, à vrai dire, ce que je faisais ni comment m’y prendre. Le livre était beau et j’avais envie de le transcrire, de le faire chanter en français, de m’approprier ainsi sa puissance peut-être. Ce mélange de savoir et d’imaginaire, de commentaire implicite et de reformulation littéraire, de fidélité et de liberté, propres à la traduction, me réjouit. J’aime sans doute longer les côtes d’un texte, comme une forme de cabotage, en épouser les contours, comme on suit sur le terrain l’itinéraire d’une carte, et observer les infléchissements, les reliefs, les surprises qui ne cessent de surgir entre les deux langues. Une caresse peut-être, comme une forme de reconnaissance de l’autre. Et de soi. »
« Vous avez traduit le poète qui nous intéresse ici: Attila József ( « Ni père, ni mère », édition Sillage, Paris, 2010.) Comment avez-vous découvert ce dernier? Et pourquoi avoir décidé de le traduire lui, poète finalement assez peu connu en France? »
G.M: « Quand on apprend le hongrois, il est difficile (heureusement) de passer à côté d’Attila József. Il est une icône en Hongrie. Je connaissais ses poèmes et je les prenais et reprenais toujours avec l’impression que je ne saurais jamais le traduire… Puis, un jour, j’ai fait un essai et à ma grande surprise il m’a presque paru concluant ainsi d’ailleurs qu’à l’éditeur, Sillage. Je me suis rendu compte alors que beaucoup des traducteurs d’Attila József étaient soit des Français qui ne maîtrisaient pas le hongrois, soit des Hongrois dont le français n’était pas la langue maternelle. J’ai donc choisi de poursuivre l’expérience et de traduire un recueil entier. Je ne voulais pas proposer une anthologie, parce qu’Attila József était déjà relativement mieux connu quand même que beaucoup d’autres poètes hongrois. »
» Comment avez-vous sélectionné les poèmes que vous avez traduits? »
G.M: « En effet, il existait déjà un livre de ses poèmes complets chez Phébus, qui était épuisé et plusieurs petites anthologies plus ou moins bien diffusées. Mais je souhaitais que les lecteurs français puissent ouvrir un recueil tel qu’il se présentait à sa parution, presque comme s’il s’agissait d’un nouveau poète, à découvrir, avec le retard dû aux traductions des prétendues « petites langues ». Le recueil aussi est une unité essentielle en poésie, pas seulement le poème. Ni père ni mère m’a paru emblématique – on y trouve beaucoup de ses poèmes les plus célèbres, par exemple « Coeur pur », « Tiszta szívvel », souvent mis en chanson, y compris en français, et d’autres très beaux textes dont beaucoup m’étaient déjà familiers. Les traduire a été une manière de les voir autrement. Une façon d’approfondir le contact avec eux, un peu comme lorsque l’on revient sur des lieux connus, dans la vraie vie ou en rêve, et les perçoit différemment. »
« Pouvez-vous nous dire brièvement ce que vous évoque le poème « Ode », qui a été traduit par Jean Rousselot? »
G.M: « J’aime beaucoup certaines traductions de Jean Rousselot, notamment sa version de La Tragédie de l’homme, le poème dramatique qui développe la philosophie de l’histoire d’Imre Madách – une des oeuvres poétiques hongroises les plus importantes, l’une des plus traduites en français et qui fut même représentée plusieurs fois en France. Et je trouve cette version de « Óda » très valeureuse ! »
« Le français et le hongrois étant deux langues très différentes, cela n’est-il pas compliqué de retranscrire l’essence même du poème, tout en conservant les rimes? Ainsi, cela n’est-il pas plus difficile de traduire le vers plutôt que la prose? »
G.M: « La contrainte de la rime – que j’ai tout de même beaucoup assouplie pour traduire Attila József, à l’image de l’original souvent simplement assonancé, mais aussi pour éviter de forcer le texte avec une forme trop rigide – , est en réalité plutôt féconde. Elle aide plutôt qu’elle n’entrave. Parfois, la grande plaine de la prose pourrait même laisser le traducteur plus démuni. Il doit en tout cas chercher la contrainte ailleurs que dans la tradition, souvent partagée de langue à langue européennes, de la forme. »
« Ecrivez-vous vous même des poèmes? »
G.M: « Effectivement, j’écris des poèmes, tantôt en vers libres, tantôt en vers réguliers. J’ai écrit beaucoup de vers réguliers depuis des années et je pense que cela doit tout de même m’aider un peu à rendre un sentiment de la forme originelle des poèmes, là où quelqu’un qui n’aurait pas cette pratique pourrait sans doute trouver la difficulté insurmontable, voire être tenté de faire la théorie de cette impuissance. À mon avis, il est important de donner aux lecteurs qui ne parlent pas la langue une idée de la forme d’origine, même si des poèmes devenus plus familiers avec le temps pourront, par la suite, être traités de façon plus fine encore, par exemple à la manière dont Pierre Klossowski a traduit l’Énéide. Toutefois, le grand traductologue Antoine Berman lui-même précise que l’histoire des traductions et des retraductions conduit à une « maturité » différente pour chaque texte et donc à des choix différents selon les époques du texte et de sa réception. À mon sens, peu de textes hongrois, trop jeunes dans notre langue, sont encore mûrs pour être traduits ainsi, mais il n’est pas impossible que cela ne tarde pas à advenir… »
« Vous intéressez-vous uniquement à la poésie hongroise, ou à sa littérature en général? Quels sont vos écrivains hongrois préférés? »
G.M: » Je m’intéresse à la littérature en général, et j’apprécie beaucoup la littérature hongroise. Mes écrivains préférés sont Sándor Petőfi dont j’aime infiniment la fraîcheur, Gyula Krúdy, surtout quand il se fait le visionnaire de la ville et semble savoir tout ce qui s’y passe et tout ce que tout le monde y pense, y compris les choses les plus légères et les plus vaines. Parmi les contemporains, je me sens très proche du poète István Kemény dont l’ironie lyrique et le sens historique me semblent très émouvants, et très familier du monde de Krisztina Tóth, dont j’admire la virtuosité narrative. »
Ayant lu plusieurs textes traduits par Guillaume Métayer, je vous en conseille fortement la lecture, et plus particulièrement celle de « Ni père, ni mère », édition Sillage, Paris, 2010.